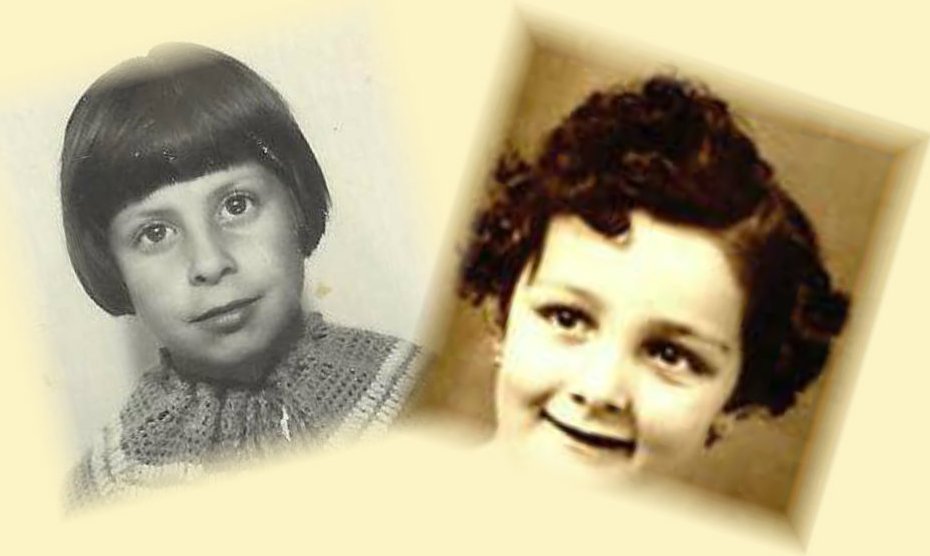36:Le bas moyen âge
Longages
"Au bas moyen âge".
La bastide de Longages:
S'organise alors que la crise économique
amorcée dés 1290 commence à être terrible.
1336: Se sont de très violents orages
qui provoquent des maladies.
Ensuite "LA PESTE" de 1347/1348 touche
toute la région.
Mais le moment le plus douloureux arrive
en octobre 1355 avec le passage du
Prince Noir.
Où il a ravagé le Saves.
Traversant la Garonne à Capens.
Marquefave et Longages
Un mois n'est pas passé qu'à nouveau
le voici retraversant la Garonne
à Carbonne le 18 novembre.
après avoir dévasté le Lauraguais.
L'état des lieux de 1356 donne l'image d'un
pays vidé,les lieux dévastés et sans successions
sont cédés à d'imprudents et
"encore rares colons".
En 1360:
Une bulle d'innocent VI
désigne le diocèse de Rieux
"Comme ayant été particulièrement éprouvé".
Cette année là Gaston Phébus
"PILLE"
toute la vallée de la Garonne.
Il recommence trois ans plus tard
En 1360:
Nouvelle épidémie de peste.
Enfin en 1368 un routier et sa bande
"Le bâtard de TERRIDE"
de son poste de Seysses ravage la contrée.
Cependant la prieure siège toujours
au couvent de Longages.
En 1380:
Le couvent parait abandonné.
En 1382:
Des paysans révoltés les " TUCHINS"
s'en prennent au couvent et aux riches
( signalés à Sajas) ils durent œuvrer
sur Longages.
En1383:
Nouvelle peste.
En 1391:
Un état des lieux donne un constat des ruines.
En 1420:
De nouveau une épidémie de peste suivie
d'une disette terrible agravée par les pillages
(commis depuis Seysses)
"Encore!!!"
par le routier espagnol
Rodrige de Villandrado.
L'année 1440:
Est catastrophique.
Et le dernier mauvais moment du siécle est en:
1457/1458
Le passage du routier écossais
Robin Petit-Lô.
Il faut attendre les alentours de 1450
pour le retour à la stabilité.
Et les années 1490 pour un repeuplement
efficace et le relèvement du Prieuré.
Le paréage.
En 1316:
Sont posées les premières bases d'un paréage
entre le roi de France et le prieuré des dames
de Fontevrault pour le lieu de Longages.
L'acte est définitivement ratifié le mardi
17 août 1322 par Arnaud de Nogaret
"notaire du royaume" par acte du
29 mars 1316 "Etienne Albert "
juge à Toulouse,le juge de la
Sénéchaussée.
Le lieutenant et Sénéchal Aymeric de Carso
procureur de la sénéchaussée,signifiaient
que PHILIPPE V ROI DE FRANCE leur avait
adressé,que le procureur de la prieure de
Longages lui avait exposé qu'il y avait lieu
de faire entre eux un paréage.
Copie du paréage.
Le procureur du roi Raymond Coste confirme
l'utilité d'une nouvelle bastide.
En 1316:
Sont posées les premières bases d'un paréage
entre:
le roy de France et les dames de Fontevrault
pour le lieu de Longages.
L'acte est complètement ratifié le:
17 août 1322
par:
Arnaud de Nogaret
"notaire du royaume".
L'espace de la nouvelle bastide.
Lorsque le paréage se conclut,le village
se présente comme un bloc de petites
bâtisses,ramassées en demi-cercle au
sud-ouest du couvent.
Si l'église paroissiale "d'alors"
notre dame était bien située sur
la terrasse du "prieuré"
elle dominait ce petit bourg.
Le cimetière
utilisé était celui qui se presse
L'espace de "la nouvelle"bastide couvre
240 arpents,le bloc du "village primitif"
est pris dans le nouvel enclos.
S'y ajoutent 40 arpents que la prieure
propose au midi pour de nouveaux
colons.
Cet espace comportait surtout des
gazailles avec pacages,jardins et vignes.
Le plan cadastral de 1830 permet de définir
l'espace de la bastide.
Le prieuré
Le château Comminges-Bruniquel.
Le château de Gestes.
et le village "primitif" y sont contenus.
Contrairement à Grenade en Hte-Garonne
la bastide de Longages
"TROP TARDIVE FUT EN GRANDE
PARTIE UN ÉCHEC"
A la suite de la mort du roi la crise
reprend autour de Rieux.
En 1606:
Les foires se sont perdues
vers 1715:
une période de reprise
il y en aura QUATRE.
En 1743:
Seule celle de la Sainte-André
(foire au cochon)sera conservée.
En 1612:
La situation de Longages cette
année là n'est pas brillante.
Les habitants du lieu sont très
misérables,paient toutes les charges et
ne possèdent pas un huitième de la terre.
Emphytéoses de la bastide
en 1720:
Grâce au "registre des censives"
présenté par les consuls de Longages
nous avons une vue sur le bourg.
Les 135 Ha de la bastide étaient
répartis entre 111 personnes.
Parmi celles-ci trois nobles.
Les Comminges-Bruniquel
les de Gestes
les de Cinovis.
deux bourgeois
Lacroix,Dulac.
Neufs notables,vingt quatre artisans
sept laboureurs vivant dans leur
"borde" située hors de la bastide
un curé (Descadeillas)
cinquante brassiers.
"Cela fait près de quatre cent vingt personnes"
possédant dans la bastide,il faut ajouter environ
soixante dix familles en dehors de la bastide qui
s'ajoute et qui forment le corps des paysans.
Le nombre de pauvres et de domestiques
est difficile à estimer.
La bastide contenait au moins
cent habitants les deux châteaux.
Les bâtiments communaux
A gauche:
La halle ancienne,la maison des consuls 1775
plus tard la maison presbytérale actuellement
le bureau de la poste.
A droite:
Rue des marchands première
maison presbytérale
"actuellement une boulangerie"
l'église Saint-André.
La moitié consistait en de très
petites demeures
"habitées par les brassiers"
vingt quatre échoppes et des ateliers
dans la grand-rue seulement une
vingtaine de maisons bourgeoises.
Les artisans:
neuf ateliers dont trois tailleurs
(Espaignol,Cassaine,Dutech)
autant de cordonniers
(Laffitte,Projean,Barbet)
trois tisserands
(Icart,Delhom,Laffont)
un boulanger (Rigail)
un presseur d'huile (Espaignol)
un boucher (Lahille)
deux charpentiers (Lachaume,Espagnol)
un maçon (Lachaume)
un menuisier (Albaret).
La tuilerie du haut était affermée.
Reule était un des deux forgerons.
Pérès et Ducros étaient jardiniers.
En dehors de la bastide
il y avait deux moulins.
Soixante quinze habitations
dont vingt trois métairies
trente deux bordes,réparties en
Quatre hameaux.
Les Delhom avaient leur "fief"à Castex.
Les laboureurs connus en 1720.
Les Pech.
Daressy.
Latou.
Girousse.
Berdoues.
Lachaume.
Les consuls de Longages.
Grand-rue à gauche l'ancienne maison
des consuls "construite en 1775"
devenue par la suite la maison presbytérale
et actuellement le bureau de la poste.
D'après les coutumes,les consuls en entrant
en charge doivent prêter serment de fidélité
à leurs devoirs,recevoir celui du bayle.
Leur nomination se faisait tous les ans
le lendemain de noël.
A défaut d'élection au temps fixé
le roi et la prieure nommaient sur
une liste les candidats.
Les consuls avaient à charge de réparer
les chemins et de punir,avec le concours
du bayle,les infractions aux règlements
de police.
La charte leur accordait la connaissance
de la justice politique et criminelle
par concours avec le juge du prieuré.
Ils étaient six,dont trois choisis par la
prieure le dimanche après la fête de
tous les saints.
Un bayle et un secrétaire commun
sont institués,ainsi que les valets
et le crieur public.
Les consuls en exercice,revêtus de leurs
livrées consulaires
"une robe mi-partie rouge et noire avec chaperon"
Ces livrées consulaires étaient la
propriété de la commune
"Qui s'imposait d'en faire l'achat".
Les consuls se rendaient à l'église avec
les électeurs pour assister à la messe.
A l'issue de l'office il y avait les
élections à la maison commune.
C'est avec ce riche costume qu'ils
assistaient aux cérémonies de l'église
sur un banc spécial.
Situé,près du chœur qu'ils recevaient
à la porte de l'église les évêques
de Rieux lors de leur arrivée,qu'ils
prenaient part aux bénédictions
des cierges des rameaux
aux processions publiques.
En 1526:
François 1er
Accorde au consulat des
privilèges qui seront confirmés
en 1565.
Quelques consuls de Longages
En 1632:
Arnaud de Lianis.
Jean de Campramond.
Jean de Perpignan.
En 1704:
Dominique Bajon (conseiller du roi)
Pierre Dumons.
François Miegemolle.
En 1710:
Arnaud Latou (premier consul)
En 1713:
Jean Dambielle.
Guillaume Idrac.
En 1720:
Jean Dumons.
Pierre Cazedebat.
Jean Delhom.
Lafont.
Charles Dulac.
Bajon (bourgeois) consul et syndic.
En 1786:
Jacques Camin.
Jean Latou.
Louis Méric.
Louis Delhom.
Jean Lambic "procureur".
Les juges de Longages.
En 1726:
François Picolle (de Carbonne)
En 1782:
Jean Antoine Cavailhès de Pomarède.
1606 trois "notables".
Les Icard.
Les Serp.
Les Perpignan.
"Le nom d'origine de ces derniers les
présente comme des juifs convertis"
nombreux en ces temps-là en vallée
de Garonne.
Les riches familles de Longages.
Gélès: une riche famille du XVIIIe
Lacroix Jean Bourgeois: en 1669
épouse Trémoulet Marguerite
du Bois de la Pierre.
Leurs biens seront partagés entre
leurs deux filles.
Arnaude:épouse de Bajon Marc
Béatrice:épouse d'Abadie Jean "notaire".
Gounin Pierre "bourgeois" seconde fortune
en 1793,propriétaire du château de la Linde.
Les nobles de Longages.
Le recensement de 1720 réalisé sur:
la"bastide"nous donne"l'occupation"
de cette dernière,trois nobles.
Les Comminges,de Gestes,de Cinovis.
Le noble Pierre de Cinovis "escuyer du roy"
seigneur de la bastide de Beaufort.
De Cinovis vivait au centre du village
"grand-rue" près de la halle.
Les Comminges - Bruniquel.
Notes:
Communiquées en 1994 par:
Madame Lucette Fort épouse
du docteur Séverin Fort "propriétaire".
Longages Saint-André:
Sous l'empire chrétien était situé
sur la voie romaine de
Toulouse à Marthes-Tolosane.
|
La commune aurait conservé de nombreuses archives qui furent maladroitement brûlées il y a un demi-siècle environ. |
Quelques documents se trouvant au château
n'ont pas été détruits,ils sont incomplets
mais permettent de fixer quelques
dates à partir de 1260.
1994:
Longages journée du patrimoine.
La façade classée monument historique en 1984.
Lucette Fort "propriétaire"
faisant visiter le parc
1260:
Acte de fondation d'un "obit" fait par
Berrnard V de Comminges.
Pour les terres situées dans le paréage
en faveur des dames religieuses de l'ordre
de Fontevrault de Longages avec le Roy de France.
1299:
Acte d'échange des terres entre Bernard de
Comminges et Arnaud de Noé qui mentionne
"l'existence d'un donus longagien".
1375:
Un testament du conte Pierre de Comminges.
Le château de construction bien plus ancienne
y est signalé dans la situation et son architecture
actuelle entre les dates de 1632 et 1735.
Divers documents de reconnaissance et de
litige existent entre les comtes de Comminges
et les dames religieuses.
Lors de la rénovation du perron
le docteur Fort,et les maçons "découvrirent "
les vestiges de briques formant un arrondi,ils
en conclurent que cela pouvait être les restes
d'une petite tour datant du moyen âge.
1720:
Reconnaissance détaillée du château,
des dépendances,des métairies du domaine
sur les trois communes.
Longages.
Le Bois-de-la-Pierre.
Carbonne.
"Documents archivés"
Emphytéose:
Des dames religieuses seigneuresses de Longages.
Un château à quatre tours.
1722:
19 juillet
Le domaine est vendu à François Abolin.
"apothicaire du roy d'Espagne"
Quittance des religieuses de Longages pour le droit
de lods des biens acquis par monsieur de Bruniquel
pour monsieur Abolin.
En 1743:
Son neveu
"apothicaire du roy de Naples"
en hérite.
Fin du XVllle -XlVe
Né à Lèzat en 1753:
de Sainte-Marie Jean Eparche.
Capitaine de cavalerie,ancien maréchal
des logis des gardes du corps du roi.
Devient acquéreur du château.
Durant un siècle il s'appellera
le château de Sainte-Marie.
Il épouse:
demoiselle de Falguière Jane Marie Cécile
née en 1759.
Leurs trois enfants.
En 1784:
Jean,Eparche,Claire.
En 1785:
Jean-Marie Joseph.
En 1788:
Jean-François Honoré Frédéric.
En 1824 Jean-François Frédéric recevra en dot
sur les terres de la Tourette un pavillon de chasse.
Lors de son mariage avec Gounin Marie-Désiré
fille du propriétaire du château de la Linde.
Vers 1830:
de Sainte-Marie
Jean-François Frédéric
fit construire le château
La Tourette.
Les travaux vont durer cinq années.
de Sainte-Marie Jean-François
a été maire de Longages de
1850-1854.
Le château Sainte-Marie en 1884.
deviendra le château Fort du nom de son
acquéreur:Le docteur Jean-François Fort.
En 2001:
Sa petite fille Elisabeth Fort le vendra à
un anglais Peter Hurn.
En 2011:
Il est mis en adjudication publique,le château
Fort a trouvé acquéreur lors de la vente aux
enchères en la personne de Monsieur
Dieudonné Duriez-Costes.
2011-2012:
Le château change de nom.
Le nouveau propriétaire:
Dieudonné Duriez-Costes a trouvé des traces
des Comtes du Comminges rappelant le
rattachement de Longages aux Comminges.
Et en particulier sur le seuil intérieur de la
tour sud-ouest et sur la terrasse sud où
figurent les armes des comtes du Comminges
ainsi que deux "ostensoirs" sculptés sur les
balustrades "rappelant"
les racines religieuses de Longages.
Les chapiteaux du château.
Les sept chapiteaux existants proviennent
de l'Abbaye de Saint-Savin-en-Lavedan
(Hts Pyrénées)
Monsieur Séverin Fort acheta vers 1960
les ruines de l'Abbaye et récupéra ainsi
quelques chapiteaux "dont 1/3 démoli"
remontés tant bien que mal dans
l'escalier en pierre du château.
Trois autres Chapiteaux du Xle siècle
sont le cloître.
des bénédictins de Tournay.
Les deux autres chapiteaux surmontant
les colonnes de marbre d'un portail
fermé par une simple grille mais maintenu
par deux élégantes colonnes portant
datation du XVle siècle.
Porte d'entrée de la pradiole
"la vierge"
proviennent problablement de la
salle capitulaire du monastère
(le couvent).
dès le Xlle siècle de l'abbaye des dames
de Fontevraut de Longages.
Sur l'une des colonnes on peut lire la date de
Portail monumental en brique et pierre
calcaire formant un "damier" ayant une
fonction à la fois défensive et ornementale.
D'aspect imposant,la construction est en
réalité creuse pour permettre aux défenseurs
On distingue sur les côtés les deux trous
par lesquels les munitions étaient projetées.
Classé aux monuments historiques en 1989.
Dans le parc une singulière orangerie:
Brique crue brique foraine et galet.
Percée d'ouvertures d'inspiration
gothique et oculus quadrilobés.
L'orangerie appartient au style troubadour.
Construite par Jean-François Fort
servant de serre l'hiver pour les
citronniers et les orangers du château
plus tard transformée en maison
d'habitation par Séverin Fort pour
y héberger son frère Jean.
1914:
Le Capdébat
(à droite de l'orangerie)
Les de Gestes.
Comme le château de Sainte-Marie le
château des de Gestes s'est élevé au XVIe
sur un ensemble de lot de la bastide.
Ce nom de Gestes est il local ou allogène?
Qui fût le premier de Gestes
Lavernose ou Longages?
Quoiqu'il en soit les "Gestes"
apparaissent dans l'histoire avec:
Jean Durand de Gestes (un roturier anobli)
qui en 1499 est seigneur du Floran
(très certainement en Astarac) et de Lavernose.
Le capitoul Jean de Gestes,est il un descendant?
Né en 1629/1682 de Gestes Jean
"escuyer" du roy.
1677:
épouse à Longages à 48 ans de Géru Isabeau
25 ans de Castillon en Couseran.
1679/1743:
né à Longages leur fils de Gestes Pierre.
Extrait du registre notaire et paraphé concernant
les "censives"dues aux dames religieuses
seigneuresses du lieu de Longages.
Noble de Gestes Pierre habitant du lieu
lequel de son plein gré,pour lui et les
siens a reconnu tenir du roy et des
dames religieuses du lieu en présence,
du procureur du roy,de moi notaire pour sa
majesté du Sieur Bricet syndic des dames
religieuses et leur procureur "fondé"pour elles.
Acceptant,stipulant,reconnaissant
en emphytéote prédations et
droits de lods à savoir:
Un château et ses terres.
Sa fille de Gestes Jeanne-Françoise
née en 1711 épousera en 1742
le seigneur de Ribonnet d'Ortet Bernard
"et lui amènera en dot"
Le château local.
Qui malheureusement a été détruit par
un incendie.Quand ???
L'acte de paréage de Longages
l'An 1322:
A été dressé dans la salle neuve du roi.
Et fut conclu par le prieur
de Longaticis "Longages"
frère Stéphanus Rossi
et la prieure Bonafemina de Montealto.
"Au château Narbonnais"
Le mardi avant la fête de
la Saint-Barnabé (apôtre)
sous le règne du sérénissime
prince Charles IV roi de France
et de Navarre.
Ruines du château Narbonnais.
Vestiges du château-médiéval
des comtes de Toulouse
construit entre 1155-1175
sur l'initiative de Raymond V
comte de Toulouse.
Le château fût bâti le long
de l'enceinte romaine.
Construit à l'emplacement
l'actuel "Palais de justice".
Hugues de Bournazel:
Conseiller et chambellan ordinaire du roi
sénéchal de Toulouse et Albi de 1461-1469.
Attesta l'exactitude de:
la transcription et la lisibilité du parchemin.
Les clercs signalèrent que:
quelques mots seulement
avaient échappé à la lecture.
Car des fragments de peau étaient tombés
en lambeaux en raison de leur grand âge.
Commentaires
-

- 1. TEJEDOR Le 18/09/2020
Bonjour,
Encore bravo pour votre travail très intéressant et titanesque.
J'ai tout lu..
A bientôt
Didier
Ajouter un commentaire